
Jesús González Requena
Amour fou dans le jardin.
La déesse qui habite le cinéma de Luis Buñuel
traduction: Annie Bussière-Cros
Edición original: Amor loco en el jardín.
La diosa que habita el cine de Buñuel
Abada Editores, Madrid, 2008
Cette edition: www.gonzalezrequena.com, 2018
- Aux limites du lisible
- Provocation, violence
- Violence et énonciation : l’énonciateur souverain
- Les paradoxes de l’avant-garde
- Sade et Buñuel : déconstruction, perversion, psychopathie
- Notas
- Provocation, violence
Aux limites du lisible
Tel est donc le programme surréaliste : contre tout refoulement : et comme l’ordre est répression, contre tout ordre. Et dans cette mesure, également, contre l’ordre même du récit. En revanche, en faveur de toute manifestation pulsionnelle, primaire, violente et destructrice.
Par conséquent, un tel programme conduit nécessairement, quand il tend à se réaliser pleinement dans le tissu discursif d’un film ou d’un poème, à un paradoxe évident. En effet, étant donné qu’il s’agit – là de discours, lui appliquer ce principe radical de rejet total de l’ordre, de la restriction, et donc de cohérence, ne peut que déboucher sur un horizon de désintégration qui conduirait inévitablement à la dissolution même du discours. Dans ces conditions, la dissolution du discours, le discours brisé, fragmenté, cassé, n’est plus désormais un discours, ou alors, çà ne peut être que le discours du psychotique – puisque, paradoxalement, ce qui le caractérise c’est justement l’échec de son organisation discursive.
Mais, alors ? Comment cela peut-il être évité ? En effet, il faut bien le reconnaître : le cinéma de Buñuel est lisible. S’il ne l’était pas, s’il était totalement illisible, alors, tout simplement, nous ne le lirions pas. Il y aurait déjà longtemps que nous l’aurions écarté et oublié. La preuve de sa lisibilité il faut la chercher dans le fait même que nous le lisons – au point de l’avoir intronisé dans les musées de cette même civilisation si violemment injuriée par le Buñuel surréaliste.
Il faut donc considérer que si cette lisibilité existe, çà ne peut qu’être le résultat de la présence en lui – au-delà de son désordre et de sa gratuité apparents – d’un certain ordre, d’un certain principe d’intégration, d’un certain ensemble de restrictions qui le structurent en un système de signification.
Provocation, violence
Et de fait, au-delà de ses évidentes incohérences narratives, L’Age d’Or trouve sa première isotopie – c’est-à-dire, son premier système d’articulation textuelle – dans l’insistante prolifération de gestes de provocation et de violence de toute sorte qui se succèdent de façon apparemment gratuite.
Nous avons eu l’occasion de commenter l’image de cette belle femme assise sur la cuvette du water, ou celle de cette étreinte lascive dans la boue, qui interrompait la cérémonie d’hommage aux Pères de l’Eglise. Plus tard, l’agression sera dirigée contre l’art lui-même : on verra un passant marcher en donnant des coups de pieds à un violon au point de le détruire – violon piétiné, ainsi érigé en représentant métonymique de l’art dans son ensemble et constitué en objet de mépris pour les surréalistes.








On nous présentera aussi, peu après, une statue classique et un respectable bourgeois portant sur sa tête de grandes pierres en forme de pains – il pourrait s’agir, après tout, de la traduction plastique d’une citation de Marx : la lutte pour les biens matériels, dont le pain constitue la manifestation la plus élémentaire, détermine les formations idéologiques et règne ainsi à l’intérieur pétrifié de la tête du bourgeois.







Ou bien ce tabernacle, placé sur le sol, dans la rue, pour que les invités de la fête passent devant quand ils descendent de leur voiture – après la mascarade organisée autour des Pères de l’Eglise, après avoir désigné le balcon vide du dernier représentant du Vatican, c’est finalement l’hostie consacrée qui devient l’objet de la mascarade.












Puis c’est la longue succession d’actes violents de l’amant arrêté et conduit par les policiers : il échappe un instant à la vigilance de ces derniers pour donner un coup de pied à un petit chien.








écraser un scarabée sous sa chaussure






insulter un paisible passant ( cochon, sauvage, tais-toi ou je te casse la gueule ! ) ou jeter au sol un aveugle d’un coup de pied pour lui arracher le taxi que ce dernier venait d’appeler.















Plus tard, arrivé à la fête, on le verra gifler la mère de la femme qu’il désire parce qu’elle a renversé involontairement sur son pantalon le verre qu’elle lui offrait.












puis, insulter violemment son Excellence le Ministre de l’Intérieur, qui se suicidera d’une balle dans la tête. Et finalement, quand la femme l’abandonne, mettre en pièces l’édredon de son lit ou jeter par la fenêtre un sapin en flamme, un évêque, une girafe…
Et l’arbitraire de ces actes de provocation et de violence trouve un plus large écho dans une autre série de manifestations de chaos et de destruction qui saturent tout le film : par exemple, en premier lieu, la mort du rat causée par un scorpion, saisie au moment même de l’attaque.












Puis la violence gratuite du groupe de bandits majorquins. Et plus tard, des édifices qui s’écroulent – Parfois le dimanche…des maisons s’écroulent » dit le carton précédant l’image de la construction qui explose et s’écroule ;







le feu qui se déchaîne dans une chambre pendant la fête, et qui semble n’affecter que le personnel de service, puisque les invités l’ignorent complètement.






le coup de feu tiré par le garde qui tue son fils, parce qu’en jouant, ce dernier lui avait abîmé la cigarette qu’il était en train de rouler.





















même la violence révolutionnaire apparaît dans les images de masses qui courent dans les rues.






Et, dans un geste final, qui provoque et atteint la figure nucléaire de la mythologie chrétienne, le Christ est identifié au chef des cruels libertins sadiens de Les cent vingt jours de Sodome. (41)




























Grito.










Violence et énonciation : l’énonciateur souverain
De sorte que la présence constante, presque monotone, de cette accumulation de gestes de provocation et de violence constitue le fil conducteur – l’isotopie dominante – qui intègre, coordonne et dote de cohérence l’ensemble des éléments du texte, au-delà de ses énormes dissonances et de ses hiatus ; c’est, en somme, ce qui soutient, rend possible et garantit dans une lecture superficielle sa cohérence discursive et, dans cette mesure, sa lisibilité.
C’est ainsi que les incessantes incohérences narratives exhibées par le film apparaissent comme un autre procédé violent qui permet au film d’agresser son spectateur – identifié au petit bourgeois prisonnier des valeurs de la culture contre lesquelles se rebelle le film. C’est pourquoi, si la narration est souvent rompue de manière gratuite, c’est une façon d’affirmer la présence souveraine de l’énonciateur du discours, qui se constitue ainsi en son protagoniste essentiel, de la même façon qu’il transforme son discours en un acte d’agression.
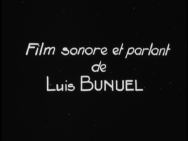
Tel est le sens conducteur qui règne sur L’Âge d’or – et à sa suite, pendant des décades, des secteurs entiers de l’intelligence occidentale ont célébré ses cérémonies dans une complicité comique – : la proclamation d’un sujet de l’écriture souverain s’affirmant sur les cendres de l’ordre symbolique qu’il contribue décidément à démolir ; un sujet qui se moque, méprise et agresse la morale et la politique, l’art et la culture, n’y voyant que des constructions imaginaires et, à la fois, des farces intolérables destinées à bâillonner le désir. L’affirmation de sa souveraineté exige, par conséquent, – à la façon nietzschéenne – de démasquer et de répudier toute loi, toute autorité et toute dette. Mais la cruauté avec laquelle cette tension se manifeste dans l’œuvre de Buñuel conduit, au-delà du propre Nietzsche, jusqu’à l’œuvre qui, à l’origine même de la modernité – et comme manifestation isolée de son visage obscur, postmoderne – a formulé de la manière la plus radicale ce double mouvement de rejet violent de toute loi et d’affirmation souveraine de la volonté de destruction : l’œuvre du Marquis de Sade.
« Jusque-là, je ne connaissais rien de Sade. Sa lecture m’a profondément étonné. Á l’université, à Madrid, on ne m’avait en principe rien caché des grands chefs-d’œuvre de la littérature universelle depuis Camoens jusqu’à Dante et depuis Homère jusqu’à Cervantes. Comment pouvais-je donc ignorer l’existence de ce libre extraordinaire, qui observait la société de tous les points de vue, de façon magistrale et systématique, et proposait une table rase culturelle. Ce fut pour moi un choc considérable. L‘Université m’avait menti. D’autres ” chefs-d’œuvre ” m’apparaissait soudain dépouillés de toute valeur, sans importance. J’ai essayé de relire la Divine Comédie qui m’a semblé le livre le moins poétique du monde – encore moins poétique que la Bible. Et que dire des Lusiades ? De la Jérusalem délivrée ?
« Je me disais : on aurait dû me faire lire Sade avant toutes choses ! Que de lectures inutiles ! (42)
C’est un Buñuel déjà âgé qui décrit ainsi sa rencontre avec l’œuvre sadienne : on le sent, alors, si longtemps après, toujours obstinément attaché à la noire révélation que cette dernière a dû lui offrir dans ses années de rébellion juvénile, fasciné sans doute par ses scènes d’horreur, mais encore plus fasciné par la logique destructrice, en même temps que violemment matérialiste, de sa philosophie.
Les paroles d’André Breton – le leader indiscuté du surréalisme – cadrent bien avec cela ; ce sont elles qui fixeront pour les décades postérieures le sens tuteur des deux premières œuvres – les seules vraiment surréalistes – de Buñuel :
« Un chien andalou et, surtout, L’Âge d’or, place le public, pour la première fois, devant une série de sollicitations qu’il serait incapable d’éluder : ce n’est pas un rêve et il n’y a pas de code symbolique. Dans Un chien andalou, l’irrationalité la plus totale règne en maître ; dans L’Âge d’or, la passion a rompu toutes les digues. Et le petit bourgeois est là dans son fauteuil, il a payé pour être giflé violemment, et ne croyez pas qu’il va aller se plaindre à la direction ! La date exceptionnelle n’est pas, selon moi, celle de Un chien andalou, mais celle de L’Âge d’or (12 décembre 1930). » (43)
Les paradoxes de l’avant-garde
Il est certainement possible – et, comme je l’ai dit, il en a été ainsi durant plusieurs décades -, de se laisser guider par cette ligne de force. De continuer à célébrer chez Buñuel l’actualisation cinématographique extrême du discours de la rébellion sadienne contre l’ordre bourgeois. Pour le reste, comme on sait, Buñuel lui-même n’a pas hésité à s’emparer de ces paradoxes, par exemple, en paraphrasant le célèbre énoncé de Breton – Le geste surréaliste le plus simple consiste à sortir dans la rue un revolver au poing et à tirer au hasard sur les gens -, il affirma que Un chien andalou n’était rien d’autre qu’un appel à l’assassinat adressé au public. (44)
Sans doute est-il possible de le faire… mais tout semble indiquer qu’il s’agit là d’une voie qui ne conduit pas très loin. Et qui, par ailleurs, ne présente aucun intérêt à notre époque où, comme Breton lui-même le confessera à Buñuel des années plus tard – en 1955 – :
« Malheureusement, il faut le reconnaître, mon cher Luis ; mais le scandale n’existe plus. » (45)
Par ailleurs, avec le recul du temps, on est en droit de se demander si ce scandale si cher aux jeunes surréalistes a réellement existé lors de l’apogée de ce mouvement. Ces mêmes années vingt n’étaient-elles pas célèbres pour la désinvolture et le libéralisme de leurs mœurs ? Et aussi, bien sûr, pour la radicale érosion de leurs valeurs bourgeoises qui avaient provoqué l’hécatombe de la Première Guerre Mondiale.
C’est pourquoi il faudrait, pour mieux comprendre les manifestations artistiques de ces années-là, prendre un certain recul par rapport à la rhétorique héroïque – et révolutionnaire – des déclarations et des manifestes de ses protagonistes. Finalement, Buñuel n’a pas à utiliser les pierres qu’il avait mises dans ses poches pour aller à la première de L’Âge d’or : son public éclata en applaudissements enthousiastes. Et ce fut le riche vicomte qui finança la réalisation du film.
Il est vrai qu’en 1955 beaucoup de choses avaient changé, comme le reconnut un Breton désormais sans illusions. Mais ce changement consistait moins en la fin du scandale qu’en la fin de la valorisation des conduites, des actes et des œuvres que les surréalistes trouvèrent auprès du public raffiné des années vingt. A cette époque, à l’aube de l’ère télévisée, le scandale avait déjà commencé à devenir une marchandise d’échange dont l’usage s’était généralisé dans la culture de masses – de fait, la rhétorique publicitaire avait incorporé à ses mécanismes de réclame les formes les plus osées des surréalistes, en leur enlevant tout leur glamour de classe.
Sans doute dadaïstes et surréalistes étaient-ils les héritiers des artistes maudits du siècle précédent – de même que ces derniers, à leur tour, prolongeaient la déchirure qui, à l’origine même de la modernité, émergea avec le mouvement romantique. Mais la leur relevait alors du genre maudit, pour ainsi dire, de deuxième si ce n’est de troisième génération. Et, à la différence de ce qui était arrivé au siècle précédent, si elle scandalisait certains secteurs de la population, elle trouvait auprès d’un autre public – précisément le plus raffiné – un accueil enthousiaste. De fait, un changement décisif de contexte avait eu lieu : les valeurs bourgeoises qui, avec toutes leurs restrictions, avaient régné au XIXème, avaient perdu désormais, après la Première Guerre Mondiale, toute leur puissance. De sorte que la mode, dans les milieux raffinés – ceux précisément qui dominaient le marché de l’art – était de les mépriser.
Il est donc possible d’envisager lesdites avant-gardes artistiques historiques moins comme une forme de rébellion minoritaire contre un univers culturel bourgeois solide et bien établi que comme la manifestation, protégée par le marché artistique d’alors, du malaise culturel – politique, et social – de la société de son temps. Un contexte, donc, dans lequel la dimension artistique révolutionnaire – entendue comme tout ce qui rejetait les formes esthétiques traditionnelles, conventionnelles aux yeux des esprits raffinés, c’est-à-dire, réduites à des formules vides de toute authenticité – était acclamée avec enthousiasme : du Cuirassé Potenkim à L’Âge d’or, mais en passant aussi par Le Triomphe de la volonté, pour ne citer que trois grandes œuvres cinématographiques par ailleurs totalement différentes, aussi bien en ce qui concerne leurs formes esthétiques que leurs cadres idéologiques de référence.
Dans le contexte de cette décomposition symbolique – qui déboucha, il faut le rappeler, sur l’essor du fascisme et du stalinisme et sur la débâcle de la Seconde Guerre Mondiale -, les œuvres des artistes d’Avant-garde cherchaient à s’affirmer dans la violence d’un geste négatif, à la fois agressif et destructeur :
« Pour la plupart – comme d’ailleurs les petits messieurs que je fréquentais à Madrid – ces révolutionnaires appartenaient à de bonnes familles. Des bourgeois se révoltaient contre la bourgeoisie. C’était mon cas. A cela s’ajoutait chez moi un certain instinct négatif, destructif, que j’ai toujours senti avec plus de force que toute tendance créatrice. L’idée d’incendier un musée, par exemple, m’a toujours paru plus séduisante que l’ouverture d’un centre culturel ou l’inauguration d’un hôpital.
« Mais c’était surtout la force de l’aspect moral qui me fascinait dans nos discussions du Cyrano. Pour la première fois de ma vie je rencontrais une morale cohérente et stricte, où je ne voyais aucune faille. Bien entendue, cette morale surréaliste, agressive et clairvoyante, allait le plus souvent à l’encontre de la morale courante, qui nous semblait abominable, et nous rejetions en bloc les valeurs admises. Notre morale s’appuyait sur d’autres critères, elle exaltait la passion, la mystification, l’insulte, le rire noir, l’appel des gouffres. Mais à l’intérieur de ce territoire nouveau, dont les contours reculaient chaque jour, tous nos gestes, tous nos réflexes, toutes nos pensées nous semblaient justifiés sans l’ombre d’un doute possible. Tout se tenait. Notre morale était plus exigeante, plus dangereuse, mais aussi plus ferme et plus cohérente, plus dense que l’autre. (46)
Epoque de révolutions : surréalistes, soviétiques, nationales socialistes… Par conséquent, époque de morales exigeantes, cohérentes et strictes : sans faille. Et, donc, dangereuses, car dominées par la passion, la mystification, l’insulte, le rire méchant, l’attraction des abîmes. Il convient de prendre au pied de la lettre les paroles de Luis Buñuel, dans la mesure où quelque chose émerge en elles qui échappe le sens tuteur dont malgré tout elles restent imprégnées. Ces petits messieurs qui s’essayaient à des postures révolutionnaires dans les salons les plus distingués et qui proclamaient leur mépris de toute morale et la farouche souveraineté de leur volonté destructrice et révolutionnaire le faisaient, finalement, parce qu’ils avaient besoin, pour contenir le malaise qui les habitait, en écho du mal-être culturel de leur temps, d’une morale sans appel.
S’il y a quelque chose de surprenant dans cette citation de Buñuel c’est la simplicité avec laquelle, de façon inattendue, le cinéaste emploie le terme qui contredit, de façon évidente, les présupposés du mouvement surréaliste auquel il participait : le plus méprisé de tous les termes, le terme moral. Une simplicité finalement désarmante dans laquelle on peut entendre ce qui, après tout, constitue sa dimension essentielle : la localisation d’une dimension du sacré comme référence indispensable pour que l’action et la parole puissent accéder à leur dignité. De sorte qu’elle rend perceptible, avec le recul, ce que cachait le mépris que les jeunes rebelles de leur époque exhibèrent à son endroit : le malaise extrême d’habiter un univers dans lequel les paroles avaient perdu toute valeur, dans lequel les discours idéologiques et moraux étaient reconnus par tous comme de fragiles mascarades qui ne recouvraient que maladroitement des intérêts misérables et banales. Eux, des artistes malgré tout, savaient cela, sans en avoir une conscience claire : que la tâche de l’art est de constituer des univers sacrés capables de configurer la subjectivité des êtres. Eux, ou pour le moins les meilleurs d’entre eux, étaient après tout des moralistes : quelque chose au plus profond de leur être réclamait comme essentielle une authentique dimension morale en même temps qu’ils constataient que rien, dans l’univers qu’ils habitaient, ne la rendait possible. C’est pourquoi, à une époque où toute morale positive était détruite, leur volonté désespérée de s’affirmer dans cette dimension les conduisait à la revendiquer par la voie du paradoxe. Affirmer une morale absolument négative c’était, finalement, la seule voie possible pour maintenir vivante la dimension du sacré. C’est pourquoi ils étaient, et peut-être plus intensément que les artistes qui les avaient précédés dans des époques antérieures, des prêtres. Mais des prêtres sans panthéon, sans divinités. Leur nihilisme était, selon eux, la seule voie possible vers le sacré.
Sade et Buñuel : déconstruction, perversion, psychopathie
De fait, avec l’œuvre du Marquis de Sade, L’Âge d’or partage non seulement la volonté explicite de déconstruire, bafouer et violenter toute loi, mais aussi cette insistance monotone qui caractérise cette volonté dans les textes du divin marquis. De fait, en l’absence d’une structure narrative qui les intègre et les situe dans une échelle de valeurs gradue, leur succession n’a d’autre logique que sa nature systématique : il s’agit, de façon à la fois compulsive et obstinée, d’épuiser toutes les possibilités de transgression.
Et cependant, les nombreux gestes démesurés de violence ne réussissent jamais à atteindre le statut de transgression tant désiré. En effet, tout acte qui défie une loi ne possède pas la dignité d’un acte transgressif. Pour que la transgression existe – au sens anthropologique du terme (47) – il est nécessaire que cet acte ait lieu dans le champ du sacré.
Autrement dit : la dignité transgressive d’un acte est en relation avec la dignité de la loi que cet acte défie. Le fait est que dans l’univers surréaliste des premiers films de Buñuel – c’est-à-dire, dans l’univers cosmopolite de l’avant-garde artistique et de la gauche divine parisienne – on ne concède aucune dignité à la loi ; elle est conçue uniquement comme objet de dérision.
De sorte que la provocation si intensément recherchée ne parvient jamais à atteindre la densité désirée – et encore moins aujourd’hui, évidemment, qu’à l’époque de la sortie du film – au contraire, souvent elle paraît banale et d’autrefois, quand elle atteint des sommets de cruauté – la séquence de l’agression de l’aveugle, par exemple -, elle se dilue, se neutralise d’une certaine façon – à cause de sa discontinuité qui l’isole de ce qui l’entoure -, tel est l’effet produit par sa déconnection narrative, c’est-à-dire par l’absence d’imbrication dans la chaîne émotionnelle du récit. Prolifération donc de gestes de défi et de violence dépourvus de médiation et de différé, immédiats, et par là-même intransitifs, sans aucune insertion narrative, de sorte qu’ils se succèdent de façon à la fois compulsive, monotone et froide – vide de toute charge émotionnelle – : mais c’est là, précisément, la combinaison particulière du caractère psychopathe.
En effet, le psychopathe se définit par le caractère blindé de son moi : inaccessible à la moindre émotion – fermé donc à toute compassion -, le psychopathe se protège du réel – de la violence que renferme le monde et qui le menace constamment de désintégration – en la projetant sur l’autre : il se veut maître du réel, être invulnérable qui domine le réel dans la mesure où il l’impose à l’autre – à un autre réduit au statut de simple objet de sa jouissance. En somme, sa position peut être résumée ainsi : J’existe dans la mesure où je suis capable de détruire l’autre : c’est l’autre qui n’existe pas ; moi, j’existe, parce que je le sais, puisque je le détruis.
Mais, bien sûr, ni Sade, ni Buñuel n’étaient psychopathes : ils ne détruisaient personne, ils construisaient seulement des discours dans lesquels était représentée la destruction des autres. Et, par ailleurs, tous deux manquaient de cette témérité démesurée, de cette insolite absence de peur qui nous fascine chez les psychopathes au point de les confondre, dans certaines occasions, avec des héros. Au contraire, aussi bien l’un que l’autre étaient plutôt craintifs, toujours incapables de réaliser les actes qu’ils attribuaient à leurs protagonistes.
Par contre, leurs protagonistes étaient bien des psychopathes. Les sadiens l’étaient de manière évidente, malgré le stéréotype confus qui consiste à les taxer de libertins. Et dans leur saga s’inscrit, de façon explicite, le protagoniste de L’Âge d’or. Mais, en ce qui les concerne, la position de l’instance énonciatrice – sadienne, buñuelienne – qui dans l’un et l’autre cas choisit le psychopathe comme protagoniste peut être caractérisée, au contraire, de perverse.
Et finalement, tel est l’effet inévitable de cette voix énonciatrice qui rejetant toute loi – et donc, en premier lieu, la loi même du récit – prétend être la protagoniste souveraine de son discours : c’est pourquoi elle provoque, se moque et agresse et, de la sorte, rend hommage au psychopathe, cette figure fascinante qui, sur les ruines du récit, écarte définitivement le héros pour occuper en fin – et anéantir – sa place.
Est-il nécessaire de le rappeler : ce qui commence ainsi dans la littérature de Sade et dans le cinématographe de Buñuel constituera un fil qui traversera la modernité pour éclore, à l’échelle des masses, dans le psycho-thriller qui, depuis les années quatre-vingt, a élevé le psychopathe au rang de protagoniste exclusif des spectacles dévastés de la postmodernité ?
Notas
(41) Sade, Marques de: 1931-1935: Los ciento veinte días de Sodoma, Fundamentos, Madrid.
(42) Buñuel, Luis : 1982: Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1996 (autobiographie recueillie et ordonnée par Jean Claude Carrière), p. 256.
(43) André Breton (“Desesperada y apasionada”, dans Yasha David (Ed.): ¿Buñuel! La mirada del siglo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1966, p. 35.
(44) Pour Varietés et pour La Révolution surréaliste j’ai écrit un prologue dans lequel je déclarais que, à mon avis, le film Un chien andalou n’était qu’un appel public à l’assassinat. Buñuel, Luis : 1982 : Mi último suspiro (autobiographie recueillie et organisée par Jean-Claude Carrière), Plaza y Janés, Barcelona, 1996 p. 125.
(45) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 129. P. 142 : “ Mai 68 présenta beaucoup de points communs avec le mouvement surréaliste : les mêmes thèmes idéologiques, la même difficulté à choisir entre la parole et l’action. Comme nous, les étudiants de Mai 68 parlèrent beaucoup et agirent peu. Mais je ne leur reproche rien. Comme pourrait dire André Breton, l’action est devenue impossible, de même que le scandale.
A moins de choisir le terrorisme, comme le firent certains. Ce dernier ne peut pas non plus échapper aux discours de notre jeunesse, à ce que disait Breton par exemple : ” Le geste surréaliste le plus simple consiste à sortir dans la rue révolver au poing et à tirer au hasard contre les gens.” En ce qui me concerne, je n’oublie pas que j’ai écrit que Un chien andalou n’était autre qu’un appel au meurtre.”
(46) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1996, p. 122.
(47) Bataille, Georges: 1957: El erotismo, Tusquets, Barcelona, 1979.
